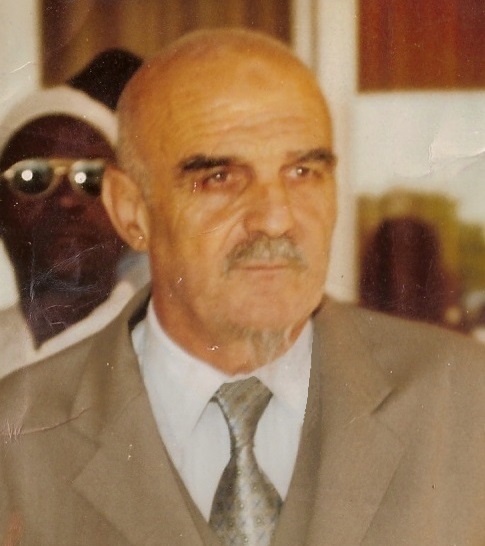
Il faut ici prendre le temps de lire le filigrane sous le constat. Serait-ce, tout d’abord, que l’expansion de toute civilisation implique des conflits ? On se retrouve ici à la racine des thèses de Samuel Huntington (1927-2008). Sans entrer ici dans le débat autour de son œuvre contestée, on retiendra pour l’instant qu’avant d’espérer développer un progrès, toute civilisation doit conquérir un espace. En cette occurrence, l’Islam (1) est manifestement de celles qui ont su accorder aux séductions commerciales, intellectuelles et spirituelles une plus grande importance qu’aux entreprises militaires. À ceci près cependant – et c’est loin d’être peu… – que la confusion entre les unes et les autres ont parfois entraîné de graves distorsions de sens dans la lecture de ses fondements religieux.
On va devoir ici commencer par distinguer ceux-ci de leurs interprétations circonstanciées. À l’instar des « nuances » entre la Torah et les halakhas des rabbins ou encore entre les Évangiles et les avis des bulles papales, il y a tout un monde en effet – et même plusieurs ! – entre, d’une part, le Saint Coran et les hadiths (2) et, d’autre part, les jurisprudences des oulémas accumulées le long des siècles et de l’immense espace islamisé. En se cantonnant au seul qui nous intéresse présentement – toute la région le long et à l’Ouest de la courbe Sijilmassa-Tamentit-Tombouctou-Bouré (le pays de l’or), du 8ème au 15ème siècle après J.C. – les trois grandes écoles de fiqh se sont avancées, sous différentes variations, à traiter la question de l’esclavage : kharidjite (ibâdite), chiite (notamment fatimide) et sunnite (malékite) ; la dernière finissant par y imposer son point de vue, dans une constante lutte entre pouvoirs maghrébins, sahariens et sahéliens pour le contrôle des routes commerciales.
Respect variable des principes islamiques
Il ne s’agit pas, ici, de rentrer dans le détail de ces péripéties qui ont en commun d’avoir surtout entretenu des conflits récurrents (3) perpétuant la dynamique esclavagiste locale, bien avant que ne se développe celle de l’Occident vers les Amériques et qui se perpétua des décennies après elle (4). Quel que ce soit l’angle de vue sur cette situation, le fait est que huit siècles après la Révélation coranique et les commentaires qu’en fit Son prophète (PBL), l’esclavage était resté, au cœur du Sahara et de part et d’autre de ses rives, une donnée incontournable, non seulement du commerce mais, aussi, de l’organisation des sociétés islamisées. On peut à bon droit s’étonner d’une telle persistance.
Certes, « l’islam n’est pas une révolution égalitaire (5). […] un minimum de transformations autoritaires, un maximum d’incitations réformatrices. Non pas l’abolition de l’esclavage – une réalité socio-économique universelle au 7ème siècle – mais l’octroi de droits pour l’esclave et la multiplication des occasions d’affranchissement ; non pas l’abolition de la propriété privée mais sa responsabilisation maximale et la valorisation du partage et de la justice ; non pas l’interdiction du profit mais seulement celle de l’usure et la reconnaissance du droit du plus pauvre ; non pas la parité mais l’harmonisation des fonctions naturelles et sociales des sexes ; non pas, enfin, l’abolition, a priori, des classes mais la prééminence de la piété sur toute considération de naissance. » (6)
Est-ce dans ces limites que se développa la plus extraordinaire encore notion d’esclavage héréditaire ? Aucun verset du Saint Coran ni le moindre hadith n’en font mention, tandis que le second khalife de l’Islam, ‘Omar ibn al-Khattâb, s’en fit le contempteur, comme le rapporte sa célèbre sentence : «« Comment se fait-il que vous réduisiez des gens en esclavage alors qu’ils sont sortis libres du ventre de leurs mères ? » (7) ; suivant ainsi le hadith rapporté par Al Boukhary : « Tout enfant naît en état de fitra (8) et ce sont ses parents qui en font un juif, un nazaréen ou un mazdéen. […] ». Même à retenir le doute quant au caractère musulman de telle ou telle captive razziée lors des guerres susdites, leurs enfants étaient donc incontestablement appelés, dès leur naissance et jusqu’à preuve de leur manifestation personnelle du contraire, à aller librement vers le Dieu Un et Unique, quelle que fût la religion de leur père respectif. Avec, en conséquence, cette question brulante : même à ne pas reconnaître pour sien l’enfant de l’« oum al walad (9) », le maître musulman de celle-ci n’en était-il pas moins tenu d’assurer l’éducation musulmane de celui-là en personne libre et son intégration à ce titre dans la société ? (À suivre).
Ian Mansour de Grange
NOTES
(1) : La majuscule, rappelons-le encore, distingue l’Islam : civilisation (à l’instar de Chrétienté) ; de l’islam : religion (à celui de christianisme).
(2) : Le tout formant les ‘oussouls (fondements) de l’islam sur lesquels les diverses jurisprudences (fiqhs) sont tenues de s’appuyer.
(3) : Durant la période susdite, au moins dix royaumes, notamment Songhaï, Sosso, Diafanu, Takrûr Soninké, Sérère et Mali, ne cessèrent de se disputer le pouvoir, de la boucle du Niger à l’embouchure du Sénégal, ponctuellement associés ou opposés à des tribus berbères, en particulier Almoravides au 11ème siècle. Une situation analogue, notons-le en passant, à ce qui se passait, à ces époques, le long des rives de la Méditerranée et jusqu’à la mer du Nord.
(4) : Dans la seconde partie du 19ème siècle, les empires peuls du Macina et du Sokoto, les deux plus grands États africains djihadistes de l’époque, auraient alors compté plusieurs millions d’esclaves. Voir Amadou Hampâté Bâ, Jacques Daget et Théodore Monod « L’Empire Peul du Macina », NEA d'Abidjan/EHESS, Paris, 1984 ; et Paul E. Lovejoy and Jan Hogendorn, « Slow Death for Slavery : The Course of Abolition in Nigeria, 1897–1936 », Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
(5) : Du moins socialement. Si, homme ou femme, blanc ou noir, arabe ou non-arabe, tous sont bel et bien égaux devant Dieu – comme le signale le Saint Coran 3 : 195 et 49 : 13, notamment – Celui-ci reconnaît l’existence de hiérarchie et classification ordonnant les sociétés humaines. Et le Prophète de préciser : « Sachez que votre Dieu est Un, que votre père originel est un. L’Arabe n’a aucune supériorité sur le non-Arabe et vice- versa, si ce n’est par la piété ; il en va exactement de même pour le Blanc par rapport au Noir : nulle supériorité si ce n’est par la piété. […] Sachez donc [aussi] que Dieu a rendu sacrés votre sang et vos biens […]. Me suis-je bien fait comprendre ? - Oui, certes ! - Que les auditeurs présents transmettent ces propos à ceux qui sont absents ! », hadith rapporté par Abû Hurayra.
(6) : Voir mon ouvrage « Gens du Livre […] », (Prix Chinguitt 2006), Éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott, 2ème édition 2025, pp. 24-25.
(7) : Unanimement reconnue authentique dans le monde sunnite, plus diversement dans les autres maḏâhib, il ne semble pas possible de désigner un rapporteur certain de cette parole.
(8) : État de nature. Un instinct selon lequel toute créature – notamment l’humain – serait, d’après l’islam, portée à aller vers Dieu dès sa venue au monde, en toute innocence et liberté. L’identité fitra-islam est spécifiquement signalée dans le verset 30 : 30 du Saint Coran.
(9) : « Mère de l’enfant » : un concept très étudié dans les différents fiqhs variablement soucieux de garantir des droits à la femme tombée enceinte au cours de son esclavage.





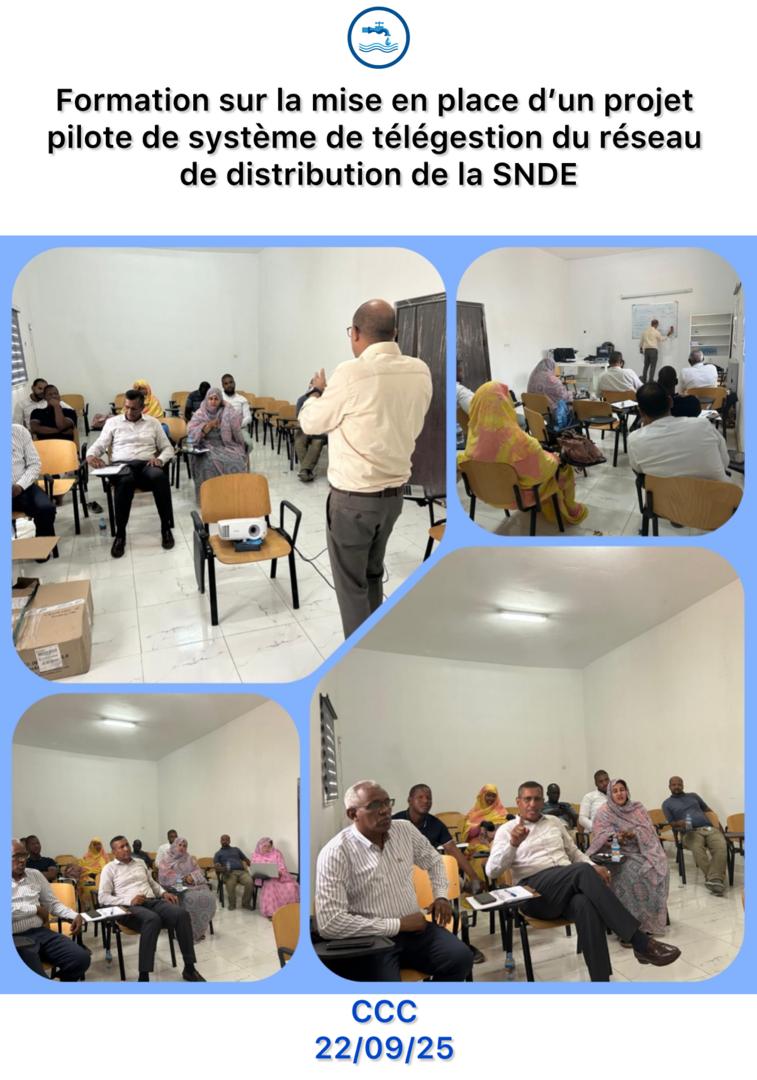
.gif)
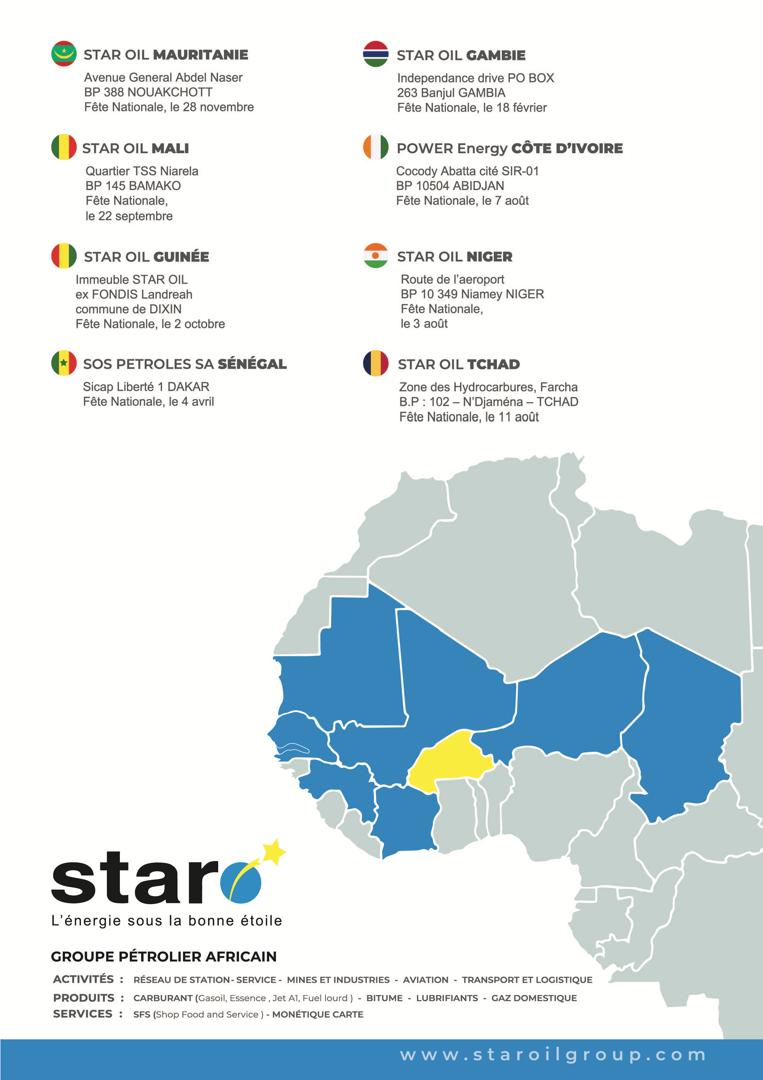

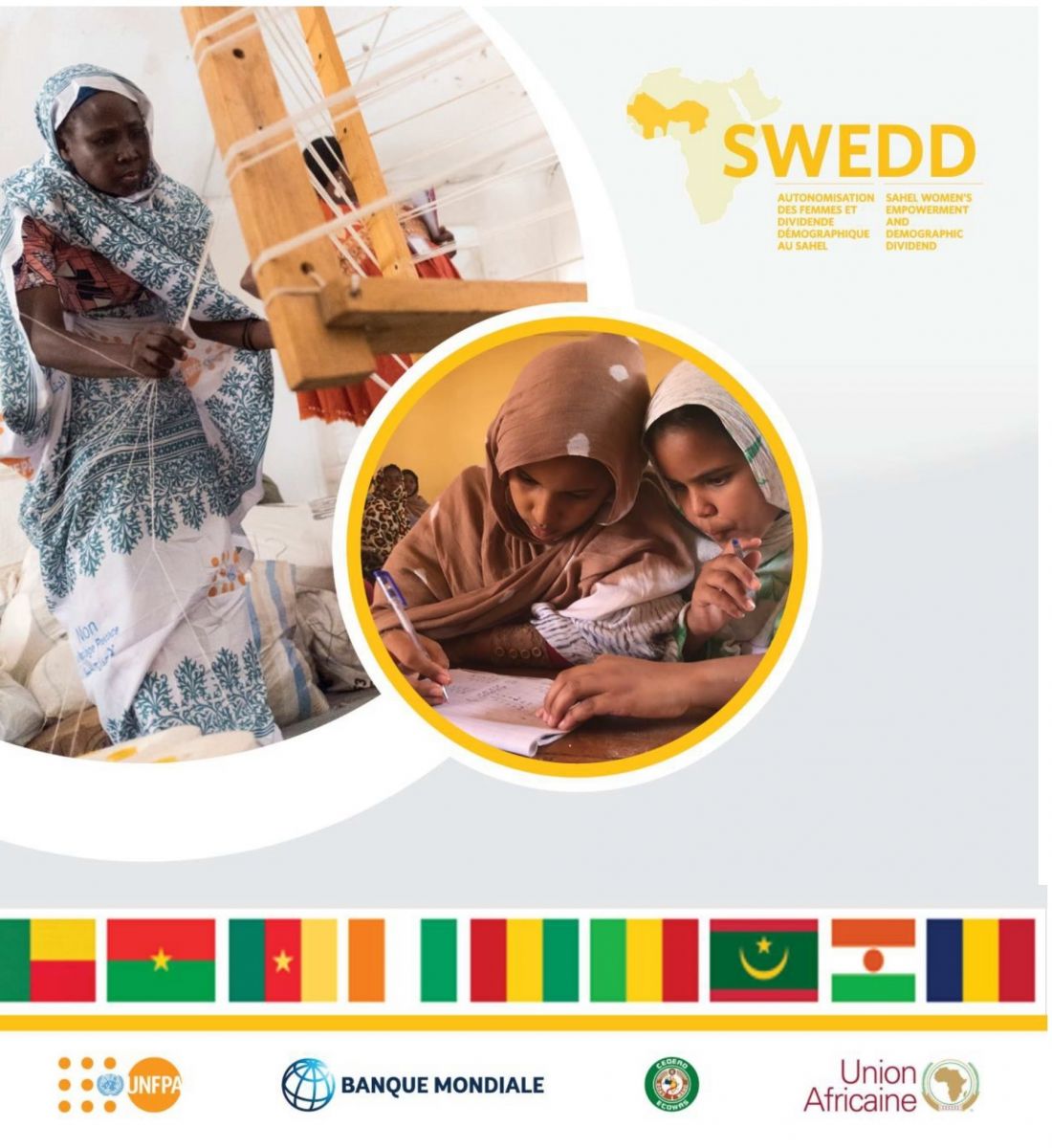
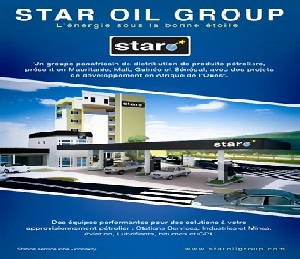




.gif)