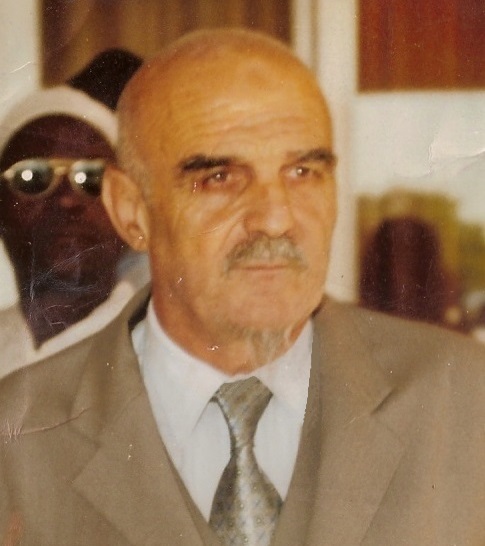
Car, outre les épices, les plumes d’autruche et l’ivoire, les Romains étaient demandeurs en main d’œuvre servile. Certes, ils étaient fort bien pourvus par leurs incessantes guerres de conquête en Europe mais n’en étaient pas moins fascinés par l’exotisme africain très inaccessible à leurs légions, alors que le développement du christianisme parmi les Berbères en ouvrait les portes, ainsi qu’y consentirent les deux premiers papes maghrébins – Victor 1er (de 189 à 199) puis Miltiade (311 à 314) – suivis du célèbre saint Augustin d’Hippone (1). Un commerce tout de même encore assez discret que la chute de l’Empire, au 4ème siècle de l’ère chrétienne, vint largement assoupir, interrompant l’ébauche de connexion entre les communautés juives africaines et européennes. Sa relance, dès le 8ème siècle et surtout au 9ème, est le fruit d’une autrement plus étonnante coïncidence. Assez rapidement intégrés, en Afrique du Nord, dans la nouvelle domination arabo-musulmane (2) qui accueille notamment les victimes des répressions catholiques, en Espagne malmenée par les oppositions doctrinales entre chrétiens ariens (3) et romains, les juifs sont d’autre part assurés, en Gaule dès la fondation de l’empire Franc par Charlemagne en l’an 800, de privilèges conséquents, fondés sur leur capacité commerciale et financière intercontinentale éprouvée par au moins un bon millénaire d’aléas divers.
Discordes monothéistes et tribales
Les récurrentes frictions territoriales entre les empires chrétiens et musulmans – tous deux scindés en parties orientale et occidentale (4) – ce n’est évidemment pas un hasard… – n’empêchent nullement les échanges commerciaux dont elles sont, en fait, autant les moteurs que les fruits amers. Seuls officiellement autorisés, dans les deux empires susdits, à pratiquer le prêt à intérêt (usurier), les juifs s’enrichissent d’autant plus, au cours des trois siècles suivants – du 9ème au 12ème siècle donc – qu’ils sont présents dans tous les centres névralgiques où se négocient les produits les produits les plus valeureux : or, argent, pierres précieuses ; et les plus rentables, notamment les esclaves et le sel. Cette situation les expose à de dangereuses jalousies qui vont, ici et là, se draper d’arguments prétendument religieux (5) pour justifier leurs exactions.
En Occident, dans un ensemble politique très instable et sous la pression croissante de multiples intérêts concurrents de ceux des juifs, c’est en vengeance de leur trahison du Christ (PBL) que « les rois et autres cités autonomes alternèrent d’abord expulsions et réintégrations, purgeant, d’une part, leurs encombrantes dettes et rétablissant, par ailleurs, de commodes intermédiaires dans la collecte des taxes » (6). En Afrique, ce sont surtout les ententes ancestrales avec les Berbères (7) qui sont mises à mal, ceux-ci étant loin de disposer d’un réseau commercial aussi cohérent que celui des juifs, étalé sur trois continents et disposant de liquidités très conséquentes. Alors plus souvent associés aux Zénètes d’obédience kharidjite, notamment dans les oasis de l’Adrar et du Touat, les juifs s’opposent aux Sanhadjas menés par le savant malékite Abdallah ibn Yassin.
La prise par celui-ci des oasis de l’Adrar puis celle, décisive, de Sijilmassa, qui réunissaient depuis trois bons siècles les voies commerciales sahariennes Sud-ouest et centrale vers le florissant Al-Andalus, déterminent la constitution de l’Empire malékite almoravide qui va s’étendre du fleuve Sénégal à la moitié Sud de l’Espagne et se maintenir en celle-ci une centaine d’années, avant de se voir supplanté par un mouvement plus spécifiquement maghrébin, les Almohades, dominés par les Masmouda, troisième grand groupe berbère, eux-mêmes évincés, un siècle plus tard, par une nouvelle dynastie zénète, les Mérinides. Ces incessants conflits inter-berbères finissent par ruiner, en Espagne, la présence musulmane de moins en moins soutenue par un judaïsme trop souvent malmené qui ne cueillera, en définitive, aucun fruit de son ambiguïté, puisqu’il se retrouvera lui aussi exclu de la péninsule ibérique en 1492, lors de la chute définitive du dernier bastion musulman à Grenade.
Islamisation du Sahel
Durant ces bouleversants quatre siècles et demi, le Sahel suit un développement marqué par l’islamisation progressive des populations, suivant celle de leurs chefs instruits, par leurs partenaires berbères, des avantages de leur conversion. Mais le kharidjisme pacifiste et notablement conciliant envers les juifs était maintenant largement dépassé par le malékisme propulsé partout dans la sous-région par les Almohavides qui encouragèrent même des djihads armés contre des non-musulmans (8) a priori pacifiques, notamment au Takrur – région du fleuve Sénégal centrée sur l’île de Morfil – sous la conduite d’une dynastie soninké, avant d’être intégré dans les empires successifs du Ghana et du Mali. En ces circonstances agitées, chaque conflit produisit son lot de prisonniers qui se voient systématiquement réduits en esclavage et introduits dans le commerce transsaharien qui prit ainsi une ampleur singulière. (À suivre).
Ian Mansour de Grange
NOTES
(2) : Moyennant, là aussi, une courbure de l’échine (paiement de la jezzi’a).
(3) : Disciples d’Arius, théologien libyen chrétien (252-386) défenseur de la nature strictement humaine de Jésus-Christ (PBL) et dont la doctrine, promue notamment par les Wisigoths, fit le lit de l’islam en Afrique du Nord, en Espagne et au Languedoc ; y déclenchant de cruelles répressions conduites par les tenants du trinitarisme romain. Voir, notamment, mon ouvrage « GENS DU LIVRE […] » (Prix Chinguitt 2006), Éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott, 2ème édition 2025, p. 46 et pp.52-53.
(4) : Empire romain d’Orient basé à Constantinople contre khalifat abbasside basé à Baghdad, d’une part, et, d’autre part, khalifat omeyyade de Cordoue contre Empire chrétien d’Occident, à cette époque plus basé à Aix-la-Chapelle qu’à Rome ; les uns et les autres confrontés à de multiples divisions internes…
(5) : Pour peu que le mot « religieux » signifie toujours d’abord « ce qui relie » et non pas « ce qui exclut ».
(6) : « GENS DU LIVRE […] » , op. cité, p.68.
(7) : « GENS DU LIVRE […] », op. cité, pp. 163-164.
(8) : Animistes, essentiellement, mais aussi, parfois, musulmans jugés schismatiques.





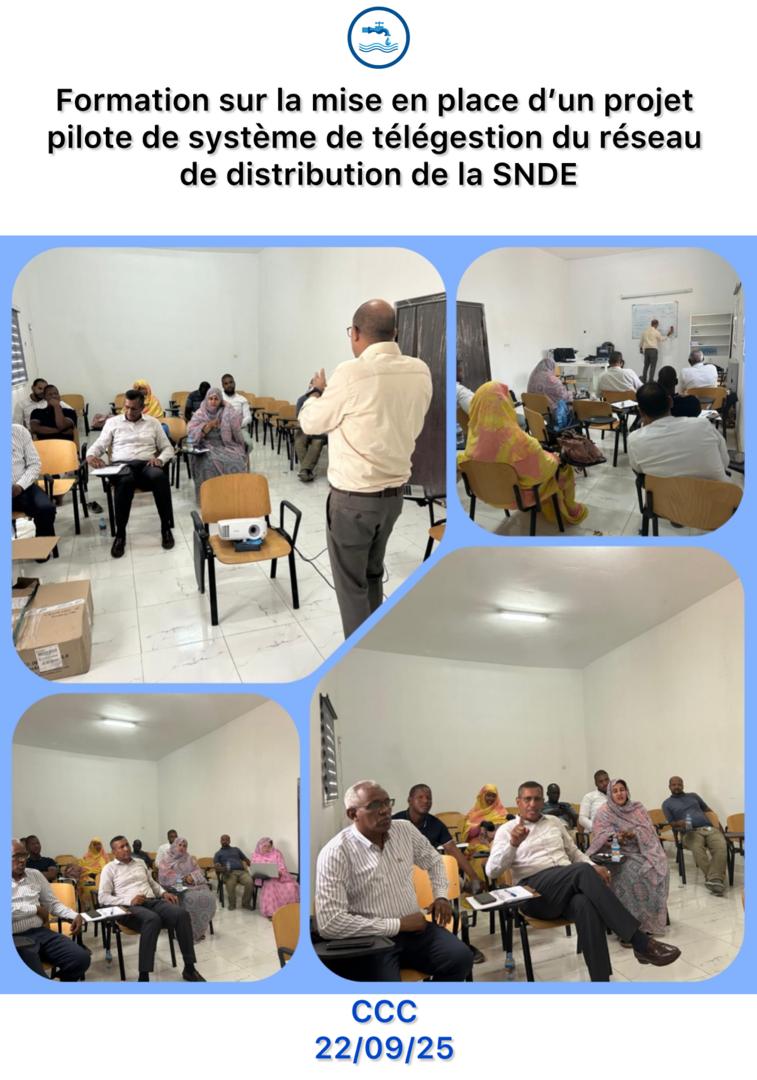
.gif)
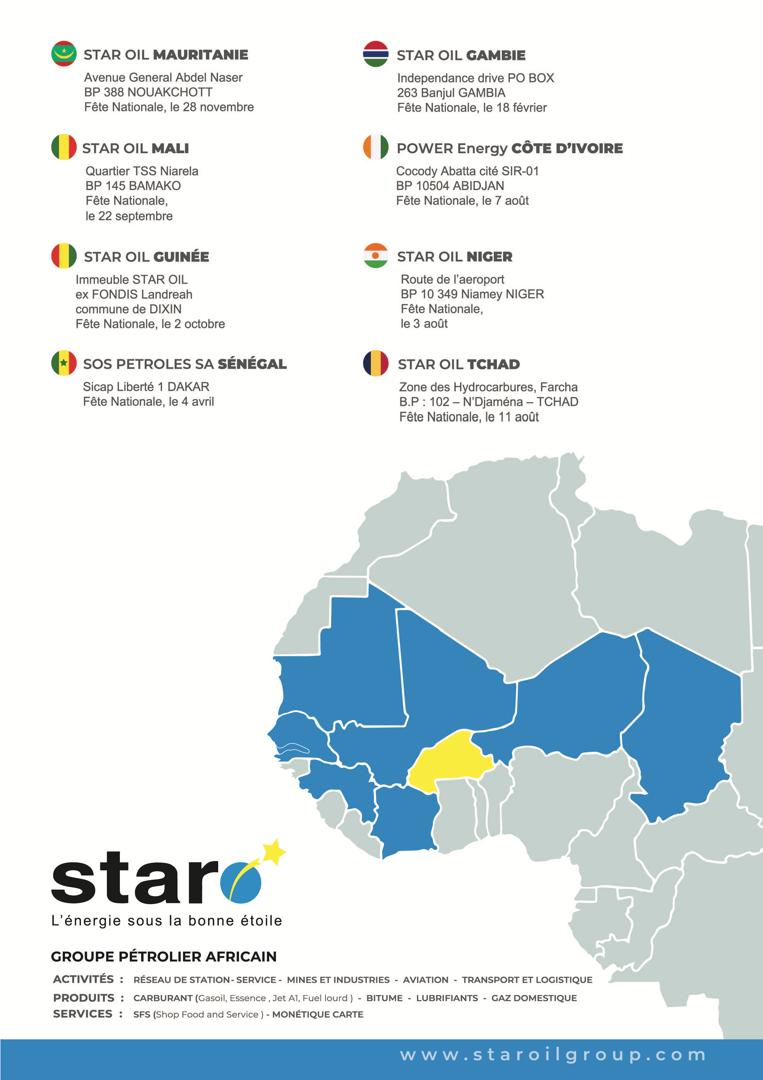

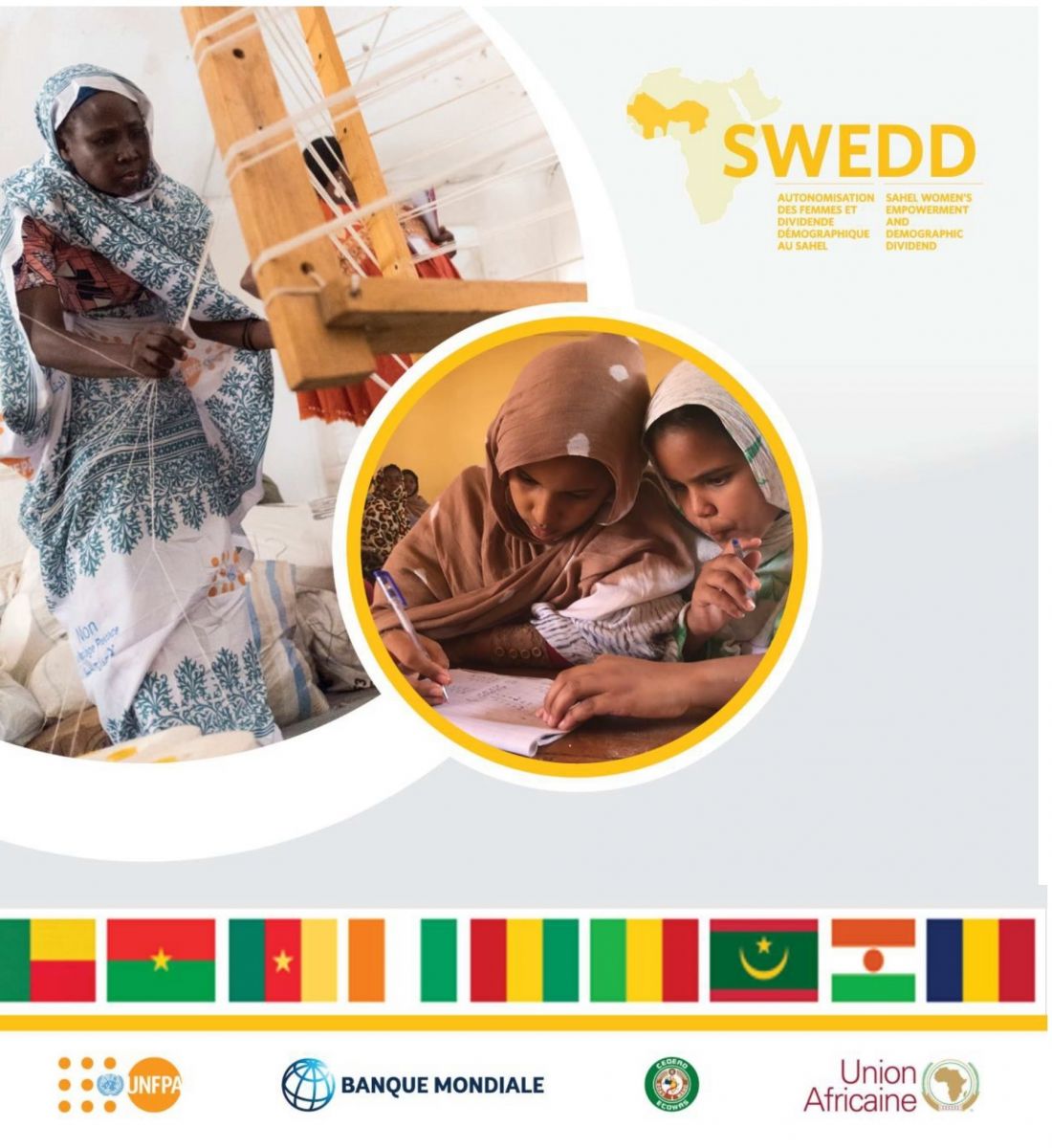
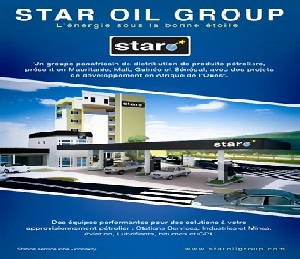




.gif)