
Depuis plus de soixante-quinze ans, le conflit israélo-palestinien n’a cessé de modeler la géopolitique du Moyen-Orient. Longtemps présenté comme une lutte territoriale entre deux peuples, il est aujourd’hui le cœur d’un engrenage plus vaste, plus violent, plus global. Une guerre silencieuse devenue visible. Une idéologie -le sionisme- devenue une force de domination militaire et stratégique. En 2024-2025, ce conflit a franchi un seuil historique : celui de l’affrontement direct entre Israël et l’Iran, avec le spectre d’une guerre régionale embrasant la planète.
Du rêve national au projet d’expansion
Le sionisme, né au XIXe siècle en réponse aux persécutions subies par les Juifs d’Europe, portait à l’origine une ambition de refuge : un foyer national pour un peuple sans terre. Mais ce rêve s’est matérialisé sur une terre déjà habitée, la Palestine, donnant lieu à une dépossession historique. Depuis la création de l’État d’Israël en 1948, puis l’occupation des territoires palestiniens en 1967, le sionisme a muté. Il ne s’agit plus seulement d’un projet de survie, mais d’un système structuré autour de la supériorité territoriale, du contrôle militaire, et d’une expansion soutenue par les puissances occidentales, en premier lieu les États-Unis.
Israël-Iran : une guerre ouverte
La guerre qui éclate désormais entre Israël et l’Iran dépasse largement la bande de Gaza ou la Cisjordanie. Depuis l’automne 2023, les frappes, les cyberattaques, les assassinats ciblés, et les opérations militaires croisées se multiplient. En avril 2024, Israël frappe des infrastructures iraniennes stratégiques ; Téhéran riposte, brisant un tabou vieux de plusieurs décennies : celui d’un affrontement direct. L’Iran n’agit plus par procuration à travers le Hezbollah libanais ou les milices chiites d’Irak et de Syrie : il entre désormais dans une confrontation frontale.
Washington, pilier indéfectible de Tel-Aviv
Face à l’escalade, les États-Unis réaffirment avec force leur soutien à Israël. Menaces militaires, renforts navals, bouclier antimissile partagé : tout indique une volonté de défendre l’État hébreu coûte que coûte, quitte à précipiter la région vers une guerre totale. Le discours officiel américain justifie cette posture par la nécessité de défendre “la seule démocratie du Moyen-Orient”. En réalité, ce soutien inconditionnel participe à verrouiller toute tentative de résolution équitable, tout en isolant davantage l’Iran.
Le silence assourdissant du monde arabe et musulman
Alors que les bombes tombent, que Gaza est asphyxiée, que l’Iran est menacé, la réaction des régimes arabes est timide, voire complice. L’Arabie saoudite, engagée dans une normalisation en coulisses avec Israël, garde le silence. L’Égypte, la Jordanie, le Maroc et les Émirats poursuivent leurs relations diplomatiques, malgré l’indignation populaire dans leurs rues. Les peuples parlent, mais les États se taisent. L’intérêt économique et la peur d’un embrasement interne étouffent toute solidarité véritable avec la cause palestinienne ou l’Iran résistant.
La prudence calculée des puissances orientales
De leur côté, la Chine, la Russie et même la Corée du Nord, souvent perçues comme les rivales de l’Occident, réagissent avec une prudence glaciale. Moscou, empêtrée dans la guerre en Ukraine, se contente de condamnations générales. Pékin appelle à la désescalade tout en renforçant ses liens commerciaux avec Tel-Aviv. Pyongyang, bruyante en temps de paix, reste étonnamment silencieuse. Le monde multipolaire, souvent présenté comme un contrepoids à l’ordre occidental, semble ici incapable -ou peu désireux- de s’opposer au rouleau compresseur israélo-américain.
L’Iran, seul contre tous ?
Dans ce contexte, l’Iran apparaît isolé, mais déterminé. Accusé d’être un “État voyou”, diabolisé dans les médias occidentaux, placé sous sanctions permanentes, il incarne pourtant la seule opposition frontale à l’expansionnisme israélien. Son soutien au Hezbollah, aux Houthis, aux groupes de résistance en Irak et en Syrie est perçu non comme une politique impériale, mais comme un contre-feu face à un axe occidental qui prétend redessiner le Moyen-Orient selon ses intérêts.
Téhéran se retrouve seul face à une coalition tacite, où Washington dicte, Tel-Aviv frappe, les Européens suivent, les Arabes se taisent, et les autres détournent le regard. Mais cette solitude est aussi une force : elle donne à l’Iran, aux yeux de nombreux peuples du Sud global, l’image d’un acteur qui refuse l’humiliation, la soumission et l’effacement. Le seul pays qui a réussi à briser le dôme de fer sans trembler ignorant l’approche des renforts américains. Les dégâts transmis sur les télévisions du monde entier en sont témoins.
Un peuple oublié : les Palestiniens
Au cœur de ce tumulte géopolitique, un peuple continue de souffrir dans l’ombre : les Palestiniens. Dépossédés, encerclés, bombardés, emprisonnés, ils subissent une politique que des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International qualifient d’apartheid. Le monde regarde, indifférent ou impuissant. Mais malgré la violence, malgré la fatigue, la résistance -armée, civile ou culturelle- ne faiblit pas. Elle rappelle que la dignité d’un peuple ne se mesure pas à sa puissance militaire, mais à sa capacité de tenir, de parler, de se souvenir.
Entre mythe historique et droit vivant
Le sionisme, dans sa forme actuelle, n’est plus une réponse à l’exil juif, ni un simple projet national. C’est devenu un levier géopolitique, une justification d’occupation, un outil de domination. Mais aucune idéologie, même portée par des millénaires de mémoire, ne peut légitimement écraser un peuple vivant sur sa terre. L’histoire n’est pas une propriété exclusive ; elle est partagée. Et la justice ne peut être différée éternellement au nom du passé. À cette guerre militaire s’ajoute une guerre de l’information. Israël exerce une censure stricte sur les médias, en particulier en ce qui concerne Gaza et les zones sous contrôle israélien. Les journalistes palestiniens sont systématiquement ciblés, intimidés ou empêchés de couvrir les événements. À Gaza, les tours de communication sont souvent les premières visées, plongeant la population dans un black-out médiatique. À l’intérieur d’Israël, la presse reçoit des directives claires : ne pas divulguer de détails sur les frappes iraniennes, sauf lorsqu’elles permettent de renforcer le récit national ou de mobiliser l’opinion publique. Par exemple, une frappe iranienne sur un hôpital est largement médiatisée pour provoquer l’indignation, tandis que d’autres frappes, tout aussi destructrices mais moins politiquement utiles, sont tues. Cette manipulation de l’information empêche un débat public honnête et renforce l’impunité des autorités israéliennes sur la scène internationale.
Si la communauté internationale persiste dans son aveuglement, si le silence reste la norme et la force la seule loi, alors ce conflit dépassera les frontières, les religions, les alliances. Il deviendra un test mondial : celui de notre capacité à choisir entre l’ordre imposé et la justice partagée.
Scheine





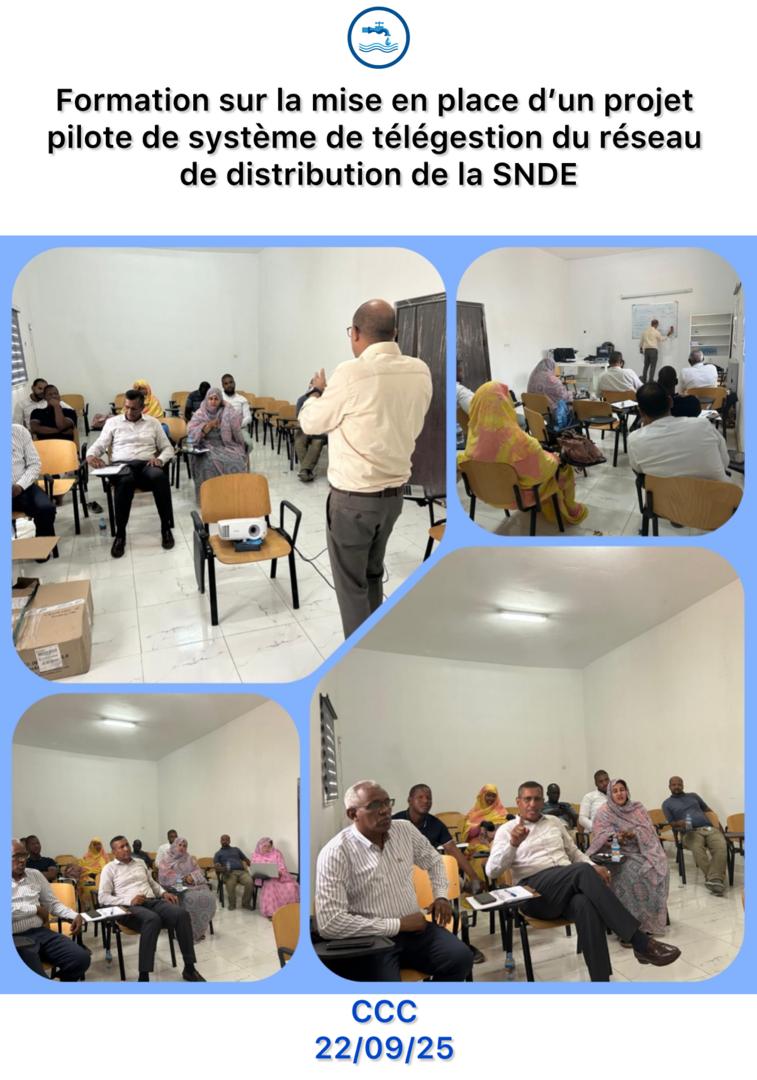
.gif)
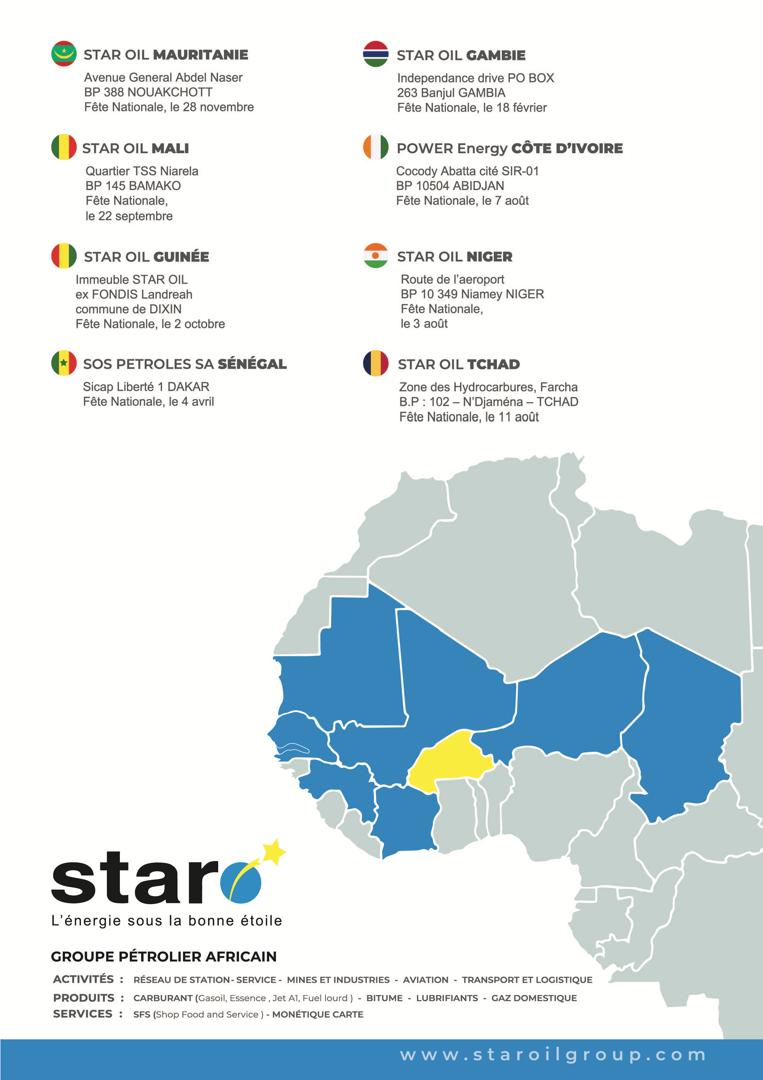

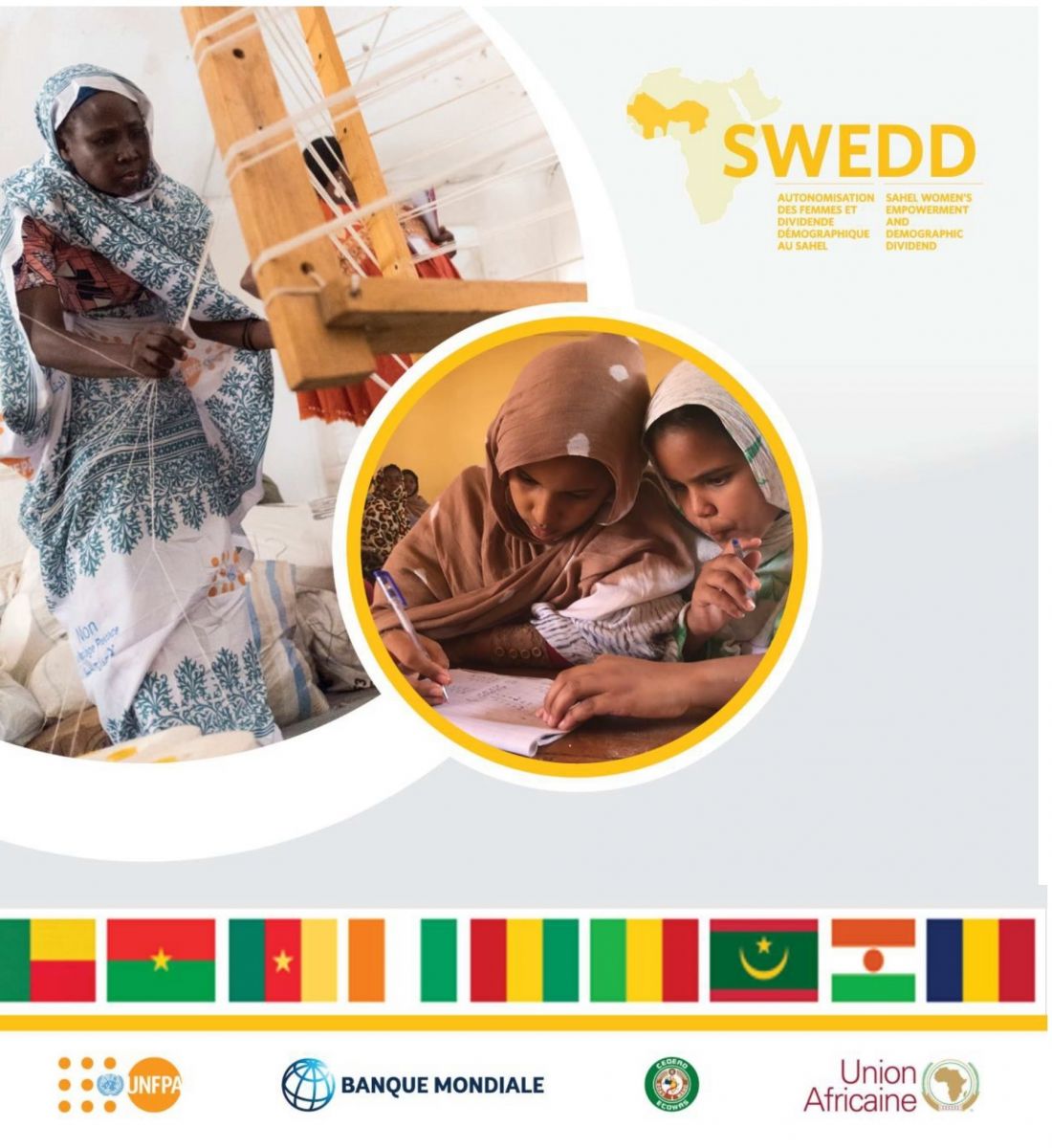
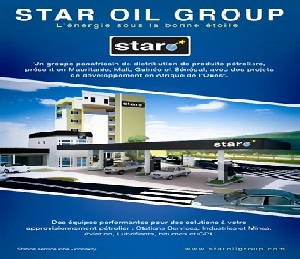




.gif)