
Il fut un temps que ces messieurs d’aujourd’hui, poudrés de vanité et parfumés d’arrogance, s’emploient à effacer d’un revers de silence l'incommodité résultant des années passées dans l'internat du Lycée national de Nouakchott. Ce temps rugueux, poussiéreux, était moins un lieu de vie qu’un rite de passage pour une jeunesse démunie, aspirant, sans le dire, à s’arracher à la boue originelle. Ce n’était pas un foyer : c’était une fabrique de douleurs partagées, une école de la rudesse où le festin se résumait à du riz pâteux servi avec des relents d’humiliation, mais qui, dans leur bouche d’alors, avait le goût de la promotion.
Aujourd’hui, les voilà : repus, engraissés par les privilèges de l’État, enrichis jusqu’à l’écœurement par des postes soigneusement alignés dans les rouages de l’administration. Ceux-là mêmes qui, jadis, léchaient les fonds de marmite et se disputaient une cuillerée de lait en poudre, jouent maintenant les aristocrates. L’eau minérale a remplacé la fontaine partagée avec les lézards, les cafards et les chiens errants. Le couscous, plat délicieux pour les Mauritaniens, souvenir trop odorant de leur misère, est banni, remplacé par des salades détox au quinoa bio. Ils se croient devenus propres et bourgeois.
Ah ! Que ces anciens internes ont la mémoire courte ! Ces statues de fortune, figées dans la pose du succès, veulent nous faire oublier qu’ils ont été nourris au lait des donateurs, quand leurs mères, héroïnes silencieuses, n’avaient même pas de quoi allaiter, car la nourriture faisait défaut. Ils oublient que leur immunité d’aujourd’hui n’a rien d’un miracle médical, mais tout d’une enfance passée à ingurgiter des repas douteux et à boire une eau qui aurait fait frémir Louis Pasteur lui-même. Mais l’eau des spas minéraux ne lave pas les souvenirs de la fontaine maudite de l’internat.
Le plus grotesque, ce n’est pas tant qu’ils aient fui leur passé, mais qu’ils cherchent à le dissimuler. Ils maquillent leur ancienne nudité morale avec des costumes trois-pièces et des montres suisses, comme si le luxe pouvait faire taire les rires moqueurs de la jeunesse famélique qu’ils ont vécue. Leurs ventres pleins d’aujourd’hui tentent d’étouffer la mémoire du vide d’hier. Mais il est des vides qui laissent une empreinte plus tenace que les pleins.
Je tire mon chapeau à ce poète arabe, qui a dit, avec une justesse cruelle :
Évite les maisons qui se sont rassasiées après la faim,
Car la faim y demeure, cachée mais fermentée.
Et cherche refuge chez celles que la faim a frappées après l’aisance,
Parce que tout bonnement le noble de cœur ne change jamais.
Et je le dis sans amertume, mais avec lucidité : je ne dénigre personne. Je n’ai ni haine ni besoin.
Méprisants voire haineux
Le style que j’emploie est volontairement percutant, non par mépris, mais pour attirer l’attention sur ce phénomène préoccupant : la métamorphose brutale de certains individus, autrefois fracassés par les incertitudes de la vie, et qu’une fonction dans l’appareil d’État a enrichis au point qu’ils en deviennent méprisants, voire haineux, envers ceux qui les ont connus dans la boue des jours anciens, ceux pour qui un morceau de pain trempé dans de la bouillie faisait office de dîner.
Il faut le dire : le capitalisme vorace de notre société et l’amour malsain de l’argent encouragent ce comportement de faux riches, ces parvenus qui confondent réussite matérielle et élévation morale.
Par pitié, qu’ils se rendent utiles, au moins ! Ces corps immunisés par la souffrance, ces organismes devenus invincibles après avoir été vulnérables à l’eau douteuse de l’internat et exposés à toutes les bactéries, qu’ils se livrent à la science ! Que leur sang, forgé dans le fer de la misère, serve enfin à quelque chose ! Ce serait là, peut-être, le seul legs véritable que ces pingres imposteurs pourraient offrir à l’humanité : leur corps comme antidote, leur mémoire cellulaire comme vaccin contre l’oubli.
Je vois encore l’un d’eux, haut fonctionnaire perclus de nervosité, squelettique malgré la fortune. La richesse l’habille, mais la misère colle toujours à son ossature. Les œufs de la pauvreté ont éclos sur sa chair et leur coquille élit encore domicile sur son visage, semblable à une médaille furtive reléguée dans l’ombre des étoiles éclatantes de son grade.
Mais non. Ils préfèrent jouer aux esthètes, aux bien-nés, aux fils de la haute classe. Comme si un soupçon de diabète mondain ou un taux de cholestérol contrôlé pouvait leur offrir le pedigree qu’ils n’ont jamais eu. Ils se tiennent droits, nerveux, vêtus de richesse. Ils ont troqué leur vérité contre le vernis des apparences. Mais qu’ils se rassurent : ceux qui ont bu l’eau de la fontaine maudite de l’internat n’ont pas besoin de diplôme pour les reconnaître. La pauvreté a éclos en eux comme une maladie congénitale : ils l’ont surmontée financièrement, mais elle transpire encore de leurs gestes.
Je rends hommage à ceux, rares mais vrais, qui, même enrichis, n’ont pas trahi leur passé ni leurs compagnons de galère. Ceux-là, je les salue. Ils savent que la richesse ne vaut rien si elle efface l’humain. Mais pour les autres, cette majorité hargneuse, ce troupeau de parvenus à l’élégance mal digérée, je n’ai qu’un mot : souvenez-vous. Le passé ne vous oubliera pas, même si vous l’avez maquillé. Il vous regarde. En silence. Dans un miroir que vous fuyez. Astaghviroulah !
أستغفر الله.
Eleya Mohamed






.gif)
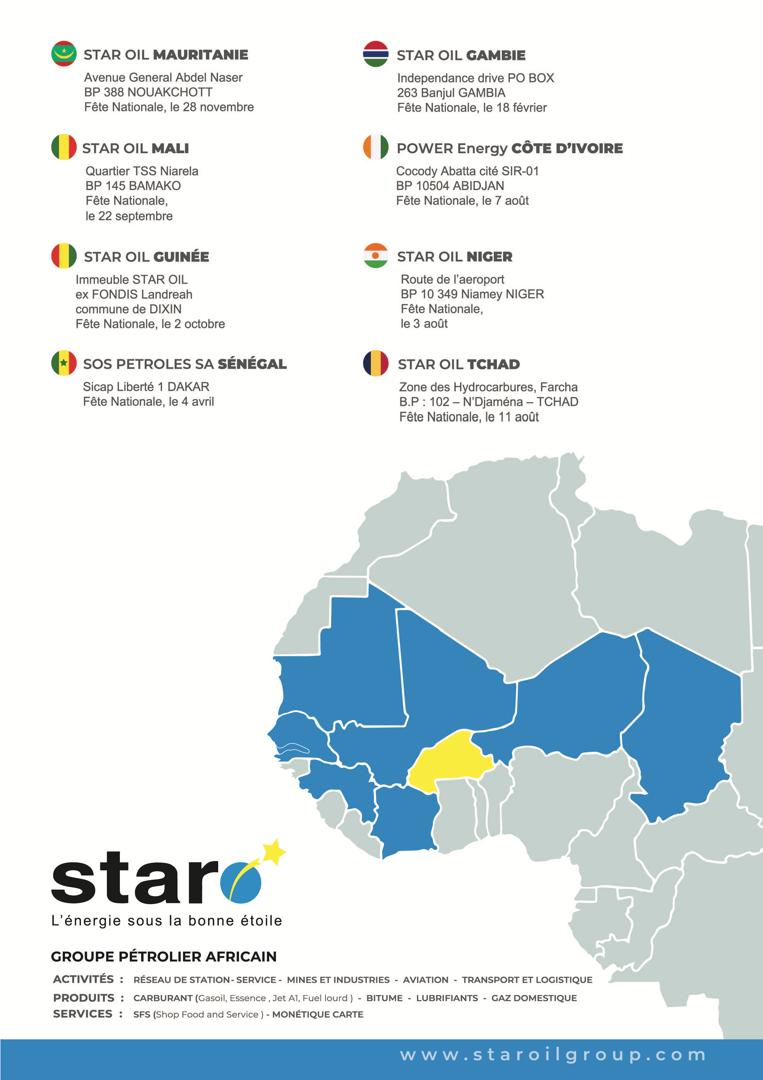







.gif)